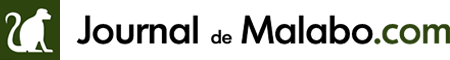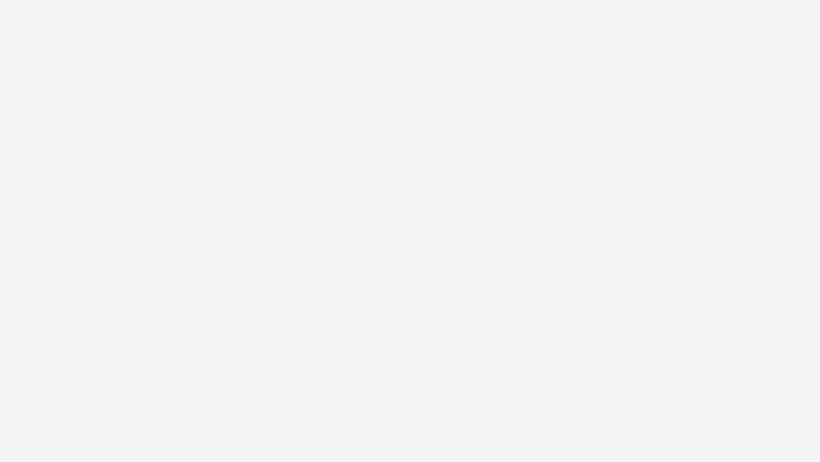Les autorités maliennes ont décidé de prolonger de 24 mois la durée de la transition, une décision unilatérale que « regrette » la Cedeao.Le samedi 4 juin dernier à Accra, au Ghana, les chefs d’Etat de l’organisation sous-régionale n’ont pas trouvé d’accord sur le dossier malien. Après de longues heures de discussions, le consensus n’était pas obtenu pour la levée de l’embargo qui fait autant mal à Bamako que dans les pays voisins, tel que le Sénégal. Le statu quo est maintenu en attendant la tenue du prochain sommet extraordinaire des dirigeants de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cedeao), prévu le 3 juillet dans la capitale ghanéenne.
Mais depuis le 4 juin, les lignes semblent bouger de part et d’autre, donnant espoir à certains acteurs que la communauté économique des Etats ouest-africains pourrait reconsidérer sa position. Lundi dernier, soit deux jours après le sommet d’Accra, le colonel Assimi Goïta a signé un décret où il fixe la durée de la transition malienne « à 24 mois, (à) compter du 26 mars 2022 ». C’est une avancée dans la crise politique car, en début d’année, les militaires maliens projetaient de diriger le pays jusqu’à cinq ans. En réaction, le 9 janvier, la Cedeao a adopté des sanctions très dures contre Bamako comme la fermeture des frontières et le gel des avoirs financiers au sein de la Bceao.
En dépit de ce pas en avant, la Cedeao n’applaudit pas pour autant les autorités maliennes. Dans un communiqué publié mardi soir, elle déclare avoir « pris acte » du décret fixant le nouveau calendrier de transition. Toutefois, « elle regrette que cette décision ait été prise à un moment où les négociations se déroulent encore, en vue de parvenir à un consensus ».
Les moutons maliens vont-ils traverser les frontières ?
Pour l’organisation sous-régionale, son médiateur de la Cedeao pour le Mali, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, « poursuivra les échanges avec les autorités du Mali, en vue de parvenir à un chronogramme mutuellement acceptable de transition, permettant d’assurer un soutien de la Cedeao ». Ainsi, elle montre clairement sa désapprobation quant au nouveau calendrier présenté par la junte malienne.
Lors du sommet d’Accra, certains dirigeants de la région campaient toujours sur une transition de 16 à 18 mois, à compter de mars 2022. En outre, le médiateur Goodluck Jonathan continue de rapprocher les positions en allant rencontrer les acteurs clés, parmi les chefs d’États de pays membres de l’institution ainsi que les autorités maliennes. Avec le président en exercice de la Cedeao, le Ghanéen Nana Akufo-Addo et le président sénégalais Macky Sall, leur visite était d’ailleurs annoncée à Bamako après la tenue du dernier sommet d’Accra. Sont-ils toujours dans les délais ?
Dans tous les cas, Goodluck Jonathan a proposé plusieurs solutions de sortie de crise, telle qu’une transition d’une durée tournant autour de 24 mois. Par conséquent, le texte méritait d’être peaufiné. Mais la manière « cavalière » qu’a eue Bamako d’annoncer la durée de la transition a irrité plusieurs chefs d’État, selon une source citée par RFI. Que va donc décider la Cedeao après avoir « regretté » la décision unilatérale des autorités maliennes ? Va-t-elle annoncer une levée partielle des sanctions qui empêchent aux éleveurs maliens, par exemple, de convoyer leurs moutons au Sénégal à l’approche de la Tabaski, la fête de l’Eid el Kébir qui sera célébrée dans un mois ?
En effet, le pays de Macky Sall compte beaucoup sur les moutons de ce pays voisin, plus accessibles parfois, pour approvisionner normalement son marché. Récemment, après une visite d’inspection, le ministère sénégalais de l’Elevage et des Productions animales a tenté de rassurer les ménages même si plusieurs d’entre eux demeurent inquiets.
Intransigeance
En revanche, Pr Abdoulaye Sounaye, spécialiste nigérien des questions sahéliennes et de l’Afrique de l’ouest, note que la Cedeao ne se prononcera sur une levée partielle ou définitive des sanctions sur le Mali avant le 3 juillet, date du prochain sommet extraordinaire de sa conférence des chefs d’Etat et de gouvernement. « Je pense que la Cedeao va attendre jusqu’à son sommet. Elle a déjà décidé d’une mission que son président va conduire. Je crois que la conférence des chefs d’Etat ne fait pas trop confiance aux autorités de la transition au Mali », indique à APA l’enseignant-chercheur à l’Université Abdou Moumouni de Niamey.
De plus, signale ce chercheur affilié au Leibniz ZentrumModerner Orient de Berlin, en Allemagne, la tâche est très difficile en ce moment pour les dirigeants de cette organisation. Ils veulent sortir de cette situation sans perdre la face, en parvenant surtout à décourager les éventuelles prises de pouvoir par les armes devenues récurrentes dans la région.
« De toutes les façons, on voit bien que la Cedeao cherche une voie de sortie de crise pour redorer son blason de la même façon que les autorités maliennes cherchent une sortie pour au moins avoir accès à certaines ressources financières. En fait, les sanctions sont devenues un véritable conundrum (casse-tête) pour les deux parties », explique Pr Sounaye.