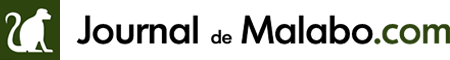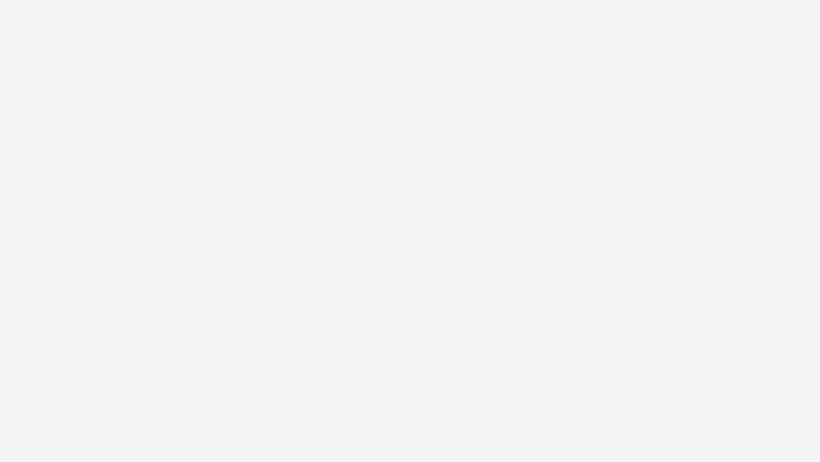Un consensus aurait pu être trouvé par les dirigeants ouest-africains réunis en sommet le 4 juin dernier à Accra, au Ghana, d’après Gilles Yabi, fondateur et directeur exécutif du think tank Wathi, interrogé par APA.Faute de consensus, les chefs d’Etats de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) ont renvoyé au 3 juillet leurs décisions sur les juntes. Comment analysez-vous cela ?
Il faudrait peut-être leur demander l’explication de cette non-décision. Je note cependant que cela n’améliore pas l’image très dégradée de l’organisation régionale au sein des opinions publiques ouest-africaines.
Comme un sommet a été annoncé, nous nous attendions donc à ce que des décisions soient prises, en particulier la levée des sanctions infligées au Mali. C’est regrettable qu’il n’y ait pas eu un travail technique et diplomatique qui aurait permis d’avoir un consensus avant la rencontre des présidents.
Les diplomates, ayant l’expérience de ce type de réunions, expliquent qu’il y a généralement un travail préalable qui permet de faire en sorte que les chefs d’Etats viennent simplement valider des orientations ou décisions quasiment prises. Mais là, nous avons l’impression qu’à chaque sommet il y a beaucoup de discussions et une absence de consensus qui auraient pu être anticipées.
Cette situation pointe les problèmes dans la manière dont les gouvernants au plus haut niveau de l’organisation régionale décident. Cela étant dit, le sommet ne devait pas se pencher seulement sur le Mali, mais aussi sur le Burkina et la Guinée. De ce fait, il est aussi dit que le sommet du 3 juillet permettrait d’avoir des décisions plus cohérentes sur les trois dossiers chauds de la région au plan politique.
Mais il y a un sentiment de gâchis, de mauvaise organisation de la Cédéao. En l’absence de l’assurance d’un consensus et d’une prise de décisions, il aurait fallu prendre le temps de lever tous les obstacles pour être sûr d’avoir un accord avec le Mali et les autres pays avant de convoquer un sommet.
A Accra,
deux camps se sont opposés sur le maintien ou non des sanctions. Peut-on parler de scission au sein de l’organisation régionale ?
Il y a effectivement des sources selon lesquelles des pays n’étaient pas d’accord avec les autres. Pour autant, je ne pense pas qu’il faille parler de scission. On n’en est pas là même s’il y a des divergences et des points de vue probablement tranchés de quelques chefs d’Etat.
En Afrique de l’Ouest, on note des problèmes de fond, des divergences dans l’interprétation des différents évènements politiques notamment les coups d’Etat (ce qui est acceptable et ce qui ne l’est pas, dans quelle mesure doit-on prendre en compte la situation spécifique de chaque pays…).
C’est beaucoup d’éléments qui entrent en ligne de compte. Malgré tout, je ne pense pas que cela induise nécessairement une forme de scission au sein de la Cédéao.
Il faut aussi savoir qu’il y a, au niveau des chefs d’Etat, des calculs justifiés par leurs propres positions : ceux qui sont en fin de second mandat et ceux qui dirigent des pays où il y a une tradition d’alternance assez bien établie et où les partis sont beaucoup plus organisés. Des différences de configuration et de pratique politiques dans les pays de la région expliquent les décisions ou les prises de positions antagonistes.
Bamako a fixé à deux ans la période transitoire. A quoi peut-on s’attendre de la Cédéao suite à cette décision unilatérale ?
Le décret du président Assimi Goïta a fait le tour du monde et des réseaux sociaux. Il est arrivé juste après le sommet de la Cédéao. Est-ce que cela va influer sur le prochain sommet ? Probablement pas.
Jusque-là, il y avait des discussions sur le délai de la transition qui paraissait comme l’élément central du désaccord entre la Cédéao et le Mali. Avec ce décret, Bamako met clairement tout le monde devant le fait accompli.
Dans le cas de la Guinée et du Burkina, il est bon de rappeler que nous avons des institutions de transition qui ont annoncé des durées de transition ne correspondant pas à ce qui était souhaité par l’organisation régionale.
Quoi qu’il en soit, lors du prochain sommet de la Cédéao, la stabilité politique et sécuritaire de la région est à placer au cœur des décisions. On doit privilégier l’intérêt supérieur des populations.
Mais cela suppose que nous sortions d’une logique de confrontation et que nous réussissions à restaurer une culture de la discussion, de la présence sur le terrain qui permet d’orienter les transitions dans la bonne direction.