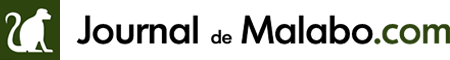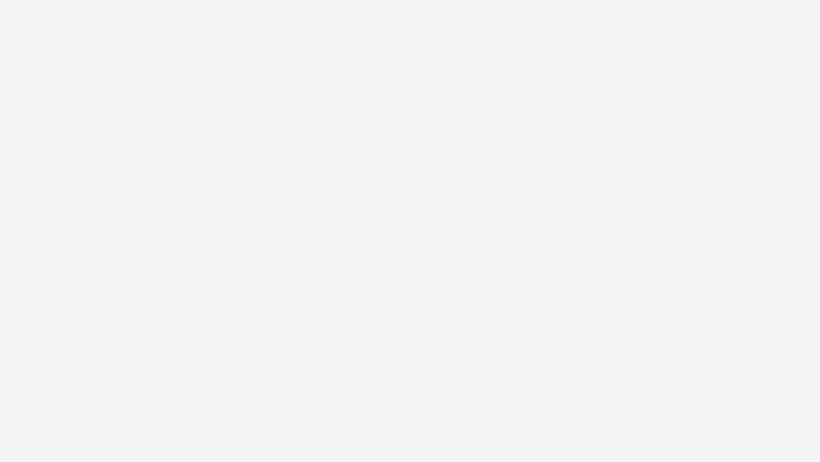La région, confrontée à la menace jihadiste, est de moins en moins sûre pour les travailleurs humanitaires.C’était un mercredi noir. Le 1er juin dernier, vers 18 heures, une équipe de la Croix-Rouge a essuyé des tirs d’hommes armés à bord de motos sur l’axe Koussané-Kayes, dans l’Ouest du Mali. Parmi les quatre membres du groupe, revenant d’une visite de terrain, le chauffeur malien et un humanitaire sénégalais sont tués.
Un drame qui relance le débat sur la sécurité des travailleurs humanitaires. Pourtant, « le droit international humanitaire prévoit clairement la protection du personnel sanitaire et des personnels de secours en temps de conflit. C’est d’ailleurs sa raison d’être. La première Convention de Genève adoptée en 1864 visait à protéger les blessés et ceux qui leur viennent en aide », rappelle le spécialiste Julien Antouly dans un entretien avec APA.
Dans le temps, cet arsenal juridique a beaucoup évolué, mais l’article 3 commun aux quatre conventions de Genève « octroie au Comité International de la Croix-Rouge (CICR), ainsi qu’aux autres organismes humanitaires impartiaux, le droit d’offrir leurs services aux parties au conflit ».
Partout où il y a des combats dans le monde, des organisations humanitaires s’emploient à remplir cette mission essentielle. « Au Sahel, la Croix-Rouge intervient aussi bien en matière de secours d’urgence que dans le cadre de projets de programmes de développement. Elle assiste les populations fragilisées par les crises sanitaires, les catastrophes, l’insécurité alimentaire et nutritionnelle, les inégalités et le changement climatique », précise Moustapha Diallo, chargé de communication de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) pour la région.
Directeur Général de Médecins Sans Frontières (MSF), Thierry Allafort explique qu’il y a un fort besoin de soins au Niger, au Mali, au Burkina et au Nigeria dans une moindre mesure. A l’en croire, dans la conduite de leurs missions, les travailleurs humanitaires ont toujours rencontré des risques.
« Mais l’aspect nouveau et particulièrement choquant des tragédies de ces dernières années est que des personnes ont été délibérément tuées bien qu’elles étaient clairement identifiées et connues en tant que membres du personnel de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, des Nations Unies ou d’Organisations Non Gouvernementales (ONG) », alertait le CICR en 1998, à l’occasion de la première réunion périodique sur le droit international humanitaire.
Une vingtaine d’années plus tard, le constat est toujours amer. Faute d’éléments suffisants accréditant la thèse de la préméditation, M. Diallo ne veut pas verser dans la spéculation, mais n’en déplore pas moins les attaques contre les travailleurs humanitaires.
« Dans de nombreuses régions où nous intervenons, être des cibles des terroristes et des milices d’auto-défense est une donnée avec laquelle nous devons composer. Il me semble que nous avons du mal à reconnaître cet état de fait », admet Thierry Allafort.
Cette tendance est confirmée par les statistiques de la base de données sur la sécurité des travailleurs humanitaires (AWSD, sigle en anglais). Rien qu’en 2020, elle a recensé 283 attaques contre 276 l’année précédente. Au total, ces assauts survenus dans 41 pays ont fait 484 victimes, entraîné la mort de 117 personnes et causé des blessures à 242 individus. A cela s’ajoute, 125 enlèvements.
Au Mali et au Burkina, en 2021, la même base de données a dénombré 52 incidents sécuritaires avec un fort taux d’enlèvements d’humanitaires. Pour la majorité des cas, les auteurs ne sont pas déterminés même si les groupes armés non étatiques sont souvent pointés du doigt.
Le 9 août 2020, six jeunes humanitaires de l’ONG ACTED ont été assassinés avec leur chauffeur et leur guide nigériens dans la Réserve de girafes de Kouré, à 60 kilomètres au Sud-Est de Niamey (Niger). Une atrocité revendiquée par la branche sahélienne de l’Etat Islamique.
Revirement
Il y a dix ans maintenant, l’action humanitaire était acceptée par les jihadistes contrôlant le Nord du Mali. Chef de la Sous-Délégation du CICR dans cette zone de novembre 2011 à novembre 2014, Attaher Zacka Maïga se souvient de sa rencontre avec Mokhtar Belmokhtar, dirigeant de la brigade Al Moulathamoune en rupture de ban à l’époque avec Al-Qaïda au Maghreb islamique (Aqmi).
« Je lui ai demandé pourquoi il a voulu discuter avec des responsables du CICR. Il a dit qu’il était au courant de notre travail et qu’il s’était déjà entretenu avec des responsables humanitaires en Afghanistan en 1990. Il a déclaré que nous étions une organisation crédible et sérieuse », a récemment témoigné M. Maïga dans la revue internationale de la Croix-Rouge.
Aujourd’hui, « les choses sont très différentes. Il existe une pléthore de groupes armés opérant au Mali avec parfois des agendas et ambitions peu clairs. Le travail humanitaire est plus difficile qu’il ne l’était en 2012 », regrette-t-il. De tous temps, argumente M. Allafort, « les négociations sont compliquées quand il y a plusieurs acteurs armés » sur le terrain.
Le document préparatoire du CICR pour la première réunion périodique sur le droit international analyse cette situation à travers la nature changeante des conflits : « La protection du personnel humanitaire expatrié et national relevait essentiellement de la responsabilité des parties au conflit. Celles-ci n’escortaient pas les équipes humanitaires, mais les laissez-passer et les autorisations fonctionnaient relativement bien. Car le système était basé sur une chaîne de commandement claire ».
De nos jours, l’action humanitaire peut être perçue comme « une entrave aux objectifs ultimes des parties au conflit ». Accusés de vouloir « évangéliser » les autochtones, Béatrice Stockly et Cecilia Narvaez Argoti, des missionnaires suisse et colombienne, ont respectivement été enlevées en janvier 2016 et en février 2017 au Mali. La première nommée a perdu la vie dans cette mésaventure.
Pour les groupes armés, le kidnapping d’humanitaires peut également être une source de revenus. Capturée à Gao, au Mali, où elle dirigeait une ONG d’aide à l’enfance, la Française Sophie Pétronin a recouvré la liberté en octobre 2020 en même temps que l’homme politique malien, feu Soumaïla Cissé et deux Italiens. En contrepartie, les autorités maliennes ont relâché plus de 200 membres présumés du Groupe de soutien à l’Islam et aux musulmans (Gsim) et auraient payé une rançon.
Tout compte fait, selon M. Antouly, le bouclier le plus efficace, « c’est de se montrer utile, neutre et impartial » sur le théâtre des opérations. « Discuter avec tout le monde, se rapprocher des communautés et adapter les opérations au contexte sécuritaire », ajoute le Directeur Général de MSF, permet de minimiser les risques. Cela dit, les organisations humanitaires ont toujours la possibilité de se retirer des zones de conflits lorsque les conditions ne sont plus réunies pour garantir la sécurité de leur personnel.