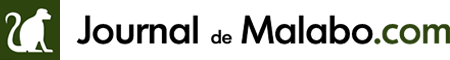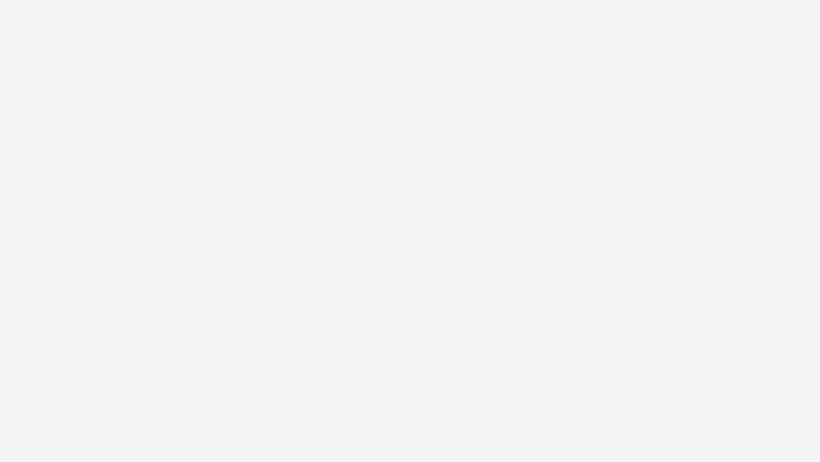La Côte d’Ivoire, premier producteur mondial de cacao, a engagé le recensement des vergers de cacao et des producteurs, y compris dans les forêts classées, une opération financée à hauteur de 6 milliards Fcfa par le Conseil du café-cacao, organe de régulation de la filière, selon un bilan partiel de l’Initiative cacao forêts allant de 2018 à 2019. «Le Conseil du café-cacao finance, à hauteur de 6 milliards de F CFA, l’opération de recensement des vergers cacao et des producteurs sur l’ensemble du territoire national, y compris les forêts classées », indique un bilan partiel de la phase pilote de l’Initiative cacao forêts «janvier 2018–décembre 2019», transmis jeudi à APA.
Cette opération de recensement des vergers et des acteurs de la filière s’inscrit dans le cadre du projet Initiative cacao forêts (ICF), qui vise à éliminer la déforestation dans la chaîne d’approvisionnement du cacao. En novembre 2017, le ministère ivoirien des Eaux et forêts et le ministère ghanéen des Terres et des ressources naturelles, ont signé à cet effet, le Cadre d’action commune (CAC) de cette initiative.
Les signataires du CAC se sont engagés à mobiliser davantage de ressources techniques et financières pour la protection et la restauration des forêts, par la recherche de mécanismes financiers innovants, y compris la création d’un fonds public-privé pour le financement des activités de l’ICF.
Les actions préparatoires pour honorer cet engagement ont consisté à élaborer le budget de la phase pilote de l’Initiative cacao et forêts. Pour cette phase pilote, il est prévu un budget de 126 milliards de FCFA, soit 210 millions dollars (193 millions d’euros), adopté en novembre 2018 par le Comité de pilotage.
Ce budget ne prend, cependant, pas en compte les budgets des entreprises signataires, non disponibles en novembre 2018. Le budget de la phase pilote de l’ICF est intégré dans le budget total, sur 10 années, de la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts, pour un montant de 616 milliards de FCFA, soit environ 1 milliard de dollars ou 939 millions d’euros.
La stratégie devrait permettre une agroforesterie et au pays de disposer à l’avenir, de plantations de cacao plus résilientes au changement climatique. Ce sont « plus de 60 millions d’arbres qui seront introduits dans les vergers cacaoyers dans les quatre prochaines années afin de reconstituer le couvert forestier».
Traçabilité et cacao durable
« Pour ce qui est du système national de traçabilité, nous avons mobilisé les fonds nécessaires à la réalisation d’une étude de faisabilité de la mise en place d’un système qui soit techniquement, économiquement, financièrement et socialement viable », assure le directeur général du Conseil café-cacao, Yves Brahima Koné.
En parallèle, insinue-t-il, le Conseil mène sur fonds propres, l’importante opération de recensement des producteurs de cacao et de leurs vergers sur l’ensemble de la zone de production. Cette opération prévue s’achever en 2020, constitue le socle d’un système de traçabilité fiable.
Elle devrait permettre de s’assurer que le cacao ne provienne pas d’aires protégées, en conformité avec les engagements des signataires de l’Initiative cacao et forêts (ICF), rapport-il.
Les entreprises du secteur développent par ailleurs des modèles financiers innovants notamment, des contrats de Paiements de services environnementaux (PSE). Avec les PSE, les producteurs sont encouragés à protéger et à restaurer les zones forestières moyennant paiement. Les entreprises ont à ce jour soutenu 1 340 producteurs au moyen de contrats PSE.
En outre, ces entreprises promeuvent l’inclusion financière pour améliorer l’accès des producteurs, particulièrement, les femmes, à des fonds de roulement et d’investissement. Elles fournissent aussi des produits financiers à 120.000 producteurs, notamment au moyen d’Associations villageoises d’épargne et de crédits (AVEC) qui soutiennent des producteurs.
L’ensemble des financements mobilisés par le secteur privé, dans le cadre de l’ICF pour l’année 2019, a été évalué par la WCF à 14,7 milliards de FCFA. Le Conseil du Café-Cacao finance également l’étude de faisabilité de mise en place de la traçabilité du cacao d’origine Côte d’Ivoire ainsi que les ateliers de lancement et de validation à hauteur de 125 millions FCFA.
Impacts du Covid-19
« La situation sanitaire due à la pandémie à coronavirus aura certainement un impact sur la mise en œuvre des actions prioritaires identifiées », estime le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi, qui veut mettre en focus des actions prioritaires et une feuille de route actualisée.
« Le plus grand défi pour nous, est la mobilisation des fonds nécessaires pour la mise en œuvre de la Stratégie de Préservation, de Réhabilitation et d’Extension des Forêts et du plan d’action de l’Initiative Cacao et Forêts », mentionne le ministre ivoirien des Eaux et forêts, Alain-Richard Donwahi.
Le financement nécessaire est d’environ 616 milliards de francs CFA, soit 939 millions d’Euros sur 10 ans, y compris le coût de la phase pilote de l’Initiative Cacao et Forêts. Il fait toutefois observer qu’ « il est évident que le budget de l’État ne peut pas tout financer ».
Pour lui, l’achèvement de la phase pilote et le déploiement de la phase active requiert la recherche de solutions aux défis majeurs, notamment la mobilisation des ressources financières requises pour la mise en œuvre d’actions concrètes.
En outre, recommande-il, le renforcement de la transparence et de la confiance entre les parties prenantes et la coordination et la synergie des actions menées par toutes les parties prenantes pour l’aboutissement de l’ICF.
« J’ai la conviction que les signataires du Cadre d’Action Commune conjugueront leurs efforts pour les relever. Ce faisant, nous montrerons au monde entier l’exemple que le secteur public et le secteur privé peuvent accomplir, ensemble, des actions concrètes nourries par le respect et la confiance mutuels pour le bien de l’industrie, de la forêt et, surtout, pour le bien-être des communautés rurales. », poursuit-il.
En vue de mobiliser les ressources financières requises pour la mise en œuvre de la Stratégie de préservation, de réhabilitation et d’extension des forêts et de l’ICF, l’Etat de Côte d’Ivoire a prévu une table ronde des bailleurs de fonds en 2020, mais la pandémie de Covid-19 pourrait ruiner cet espoir.
En ce qui concerne la création du Fonds ICF, des consultations sont en cours afin de définir la vision et le schéma national du Fonds à créer pour répondre à l’ensemble des besoins de financement des actions de protection et de conservation des forêts ainsi que de préservation de l’environnement en Côte d’Ivoire.
Le Secrétariat exécutif permanent de la commission nationale REDD+ a été mandaté pour le suivi-évaluation de l’Initiative Cacao et Forêts. L’Etat de Côte d’Ivoire ambitionne de recouvrer 20 % de son couvert forestier national à l’horizon 2030.